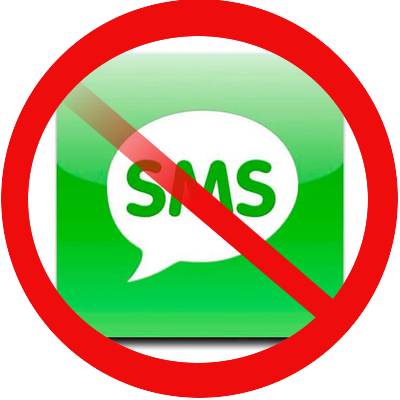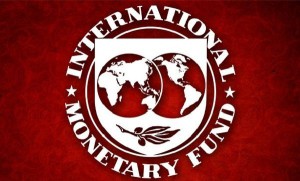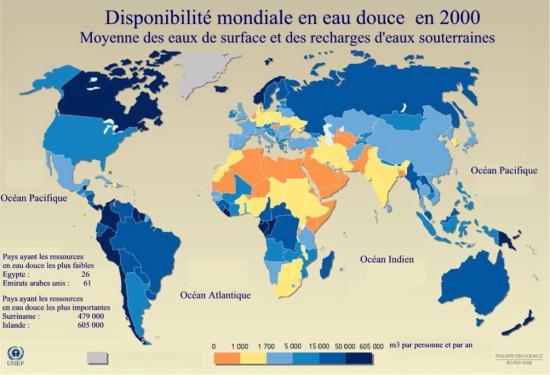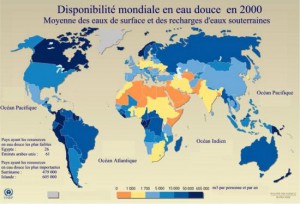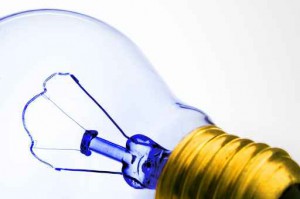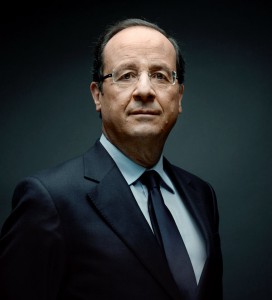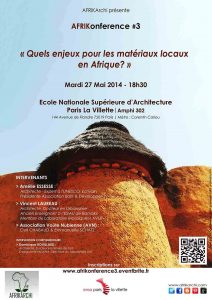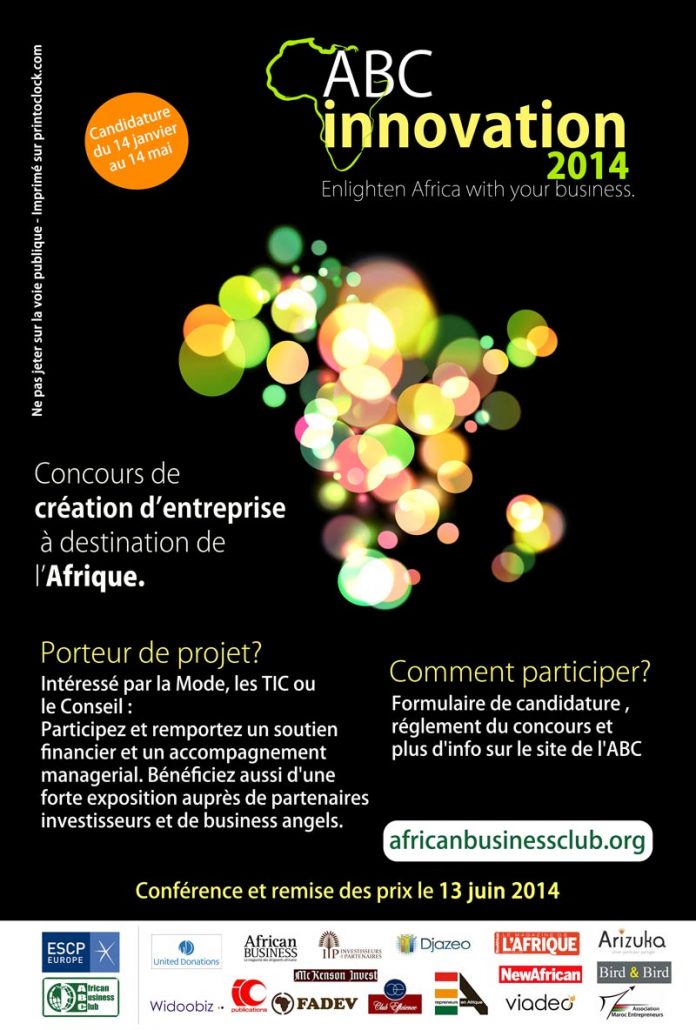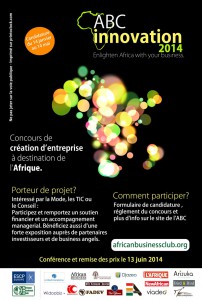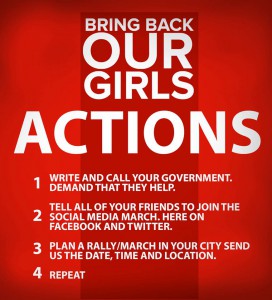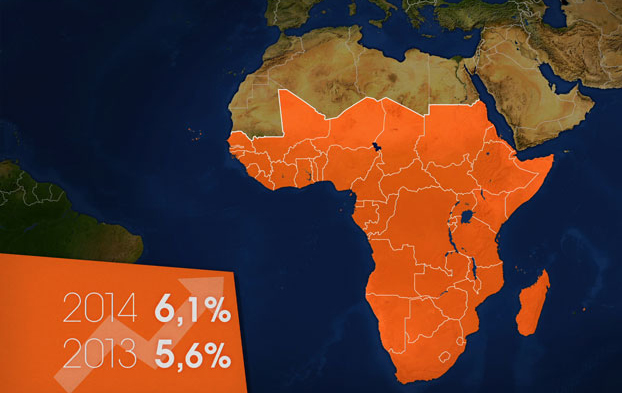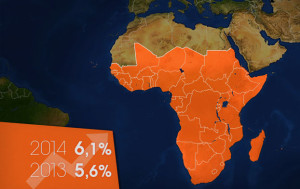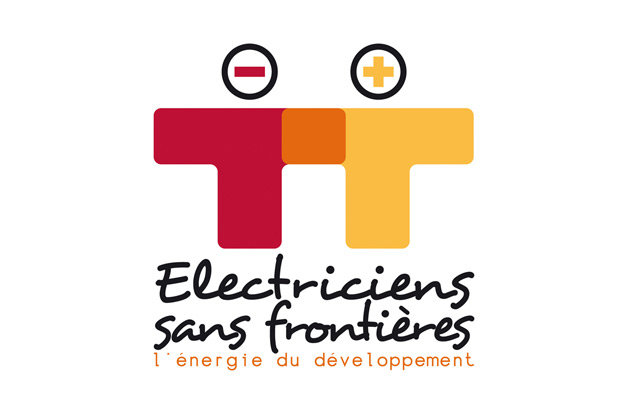La musique rwandaise n’est pas une musique comme une autre.
Elle est capable du pire et du meilleur, peut-on penser !
Cette musique dont on parle peu, a été pourtant active, depuis très longtemps, dans la vie sociopolitique du pays.
La musique rwandaise n’a pas été épargnée, en revanche, par le génocide et les massacres des années 94, elle a payé un très lourd tribut ! Les grandes personnalités musicales, tutsi et hutu tuées en ces périodes noires, restent gravées dans la mémoire des rwandais. Pourra-t-on oublier le chanteur Cyprien Rugamba avec son groupe « Amasimbi n’amakombe » ? Les chanteurs/guitaristes Rodrigue Karemera, André Sebanani, Loti Bizimana et d’autres encore s’effaceront-ils de la mémoire des rwandais?
 Ces périodes tragiques ont latéralement détruit tous les groupes musicaux appelés à l’époque « Orchestres ». Ces derniers sillonnaient le pays pour donner des concerts à des populations, même situées dans les contrées les plus difficilement accessibles. C’était, à l’époque, une vraie rencontre entre la musique et le peuple. Là aussi, les grands noms restent des monuments de l’histoire musicale du Rwanda. Les orchestres Impala, abamararungu, Nyampinga, Les citadins, et beaucoup d’autres n’ont pas pu relever la tête après ces drames.
Ces périodes tragiques ont latéralement détruit tous les groupes musicaux appelés à l’époque « Orchestres ». Ces derniers sillonnaient le pays pour donner des concerts à des populations, même situées dans les contrées les plus difficilement accessibles. C’était, à l’époque, une vraie rencontre entre la musique et le peuple. Là aussi, les grands noms restent des monuments de l’histoire musicale du Rwanda. Les orchestres Impala, abamararungu, Nyampinga, Les citadins, et beaucoup d’autres n’ont pas pu relever la tête après ces drames.
En parallèle avec cette musique plutôt moderne, la musique rwandaise est aussi riche de la chanson traditionnelle. Cette dernière s’accompagne des instruments fabriqués par les rwandais (ingoma : tambours, iningiri : sorte de violon monocorde, Umuduri : arc musical, inanga : cithare sur cuvette, etc.). Pour plus d’information sur les instruments traditionnels, lire Les instruments de musique du Rwanda: étude ethnomusicologique, par Jos Gansemans).
Musique rwandaise, espace d’expression libre ?
Dans un pays où la liberté d’expression a été mise en mal depuis très longtemps, seuls les artistes parviennent à faire passer leur message, au travers de leurs styles qui échappent subrepticement à la surveillance des politiques.
Les artistes rwandais en particulier les musiciens, savent manier le langage dans une symbolisation très imagée. Ce maniement de la pensée et de la langue n’est pas que propre aux artistes. Tous les rwandais ont appris, suite aux souffrances de leur histoire, à s’en servir tant dans le bien que dans le mal ! Cette façon d’être, de penser, d’agir et de s’exprimer propre aux rwandais rend plus difficile l’accès à la mentalité rwandaise. De là, les rwandais ne cessent de répéter à juste titre que la communauté internationale n’a, jusque-là, rien compris de l’énigme rwandaise.
 Dans une chanson « Ikantarange » : le très-lointain (dans l’espace), Loti Bizimana se sert de la symbolisation pour véhiculer son message s’insurgeant contre l’injustice dans les années 1990. Le chanteur s’adresse donc à ce personnage imaginaire « ikantarange ». Celui-ci est en effet un lieu symbolique où une catégorie de gens vit dans l’abondance alors que d’autres en face, sont dans la misère et dans la souffrance. Il termine sa chanson par cette phrase que l’on traduirait approximativement en français : personne ne maîtrise l’avenir, tout peut basculer d’un jour à l’autre : « Dore ko byinshi by’ubu buzima ntawe ubizi, bucyanayandi ni umwana w’umunyarwanda ». Le pouvoir politique de l’époque saisissait-il sur le vif le contenu et le sens de cette chanson ? S’était-il senti concerné ?
Dans une chanson « Ikantarange » : le très-lointain (dans l’espace), Loti Bizimana se sert de la symbolisation pour véhiculer son message s’insurgeant contre l’injustice dans les années 1990. Le chanteur s’adresse donc à ce personnage imaginaire « ikantarange ». Celui-ci est en effet un lieu symbolique où une catégorie de gens vit dans l’abondance alors que d’autres en face, sont dans la misère et dans la souffrance. Il termine sa chanson par cette phrase que l’on traduirait approximativement en français : personne ne maîtrise l’avenir, tout peut basculer d’un jour à l’autre : « Dore ko byinshi by’ubu buzima ntawe ubizi, bucyanayandi ni umwana w’umunyarwanda ». Le pouvoir politique de l’époque saisissait-il sur le vif le contenu et le sens de cette chanson ? S’était-il senti concerné ?
Une musique pédagogique et préventive
Cyprien Rugamba, un autre chanteur très populaire, poète et historien de formation est talentueux dans l’usage du langage imagé. Au-delà de la symbolique, c’est surtout le message pédagogique véhiculé par ses chansons qui retient l’attention. Dans la fable chantée « agaca : épervier », l’auteur intrigue par la mise en scène des volailles, des rapaces et des êtres humains (rwandais). Cette composition date aussi des années 90, la période où l’avenir du Rwanda présageait de mauvais augures. La leçon qui en découle sera toujours d’actualité. Il le dit en ces termes :
Jya wihisha ushyire kera ngo urusha abandi ubwenge Tu te caches (derrière tes mauvais actes) et tu crois
que tu es le plus habile de tous,
Ukomeze wice abantu mu mayeri Tu continues à tuer discrètement (tes compatriotes)
Umunsi utabikeka uzakacirwa Le jour viendra où tu seras traqué
Nugira ngo urahunga bibe iby’ubusa Tu auras tenté d’échapper mais en vain.
Jya wirinda iby’abandi Désormais, évite le bien d’autrui
Itegeko urigire intwaro urikurikire cyane winumire. Que la loi devienne ton arme, pour le reste tu seras bien tranquille.
La culture rwandaise vue dans son univers pluridimensionnel n’a pas échappé à la création musicale. L’unité linguistique (kinyarwanda langue unique de tous les rwandais) inspire beaucoup de musiciens qui la considèrent, à tort ou à raison, comme élément de cohésion sociale. Hélas, elle n’pas toujours joué son rôle. Elle a participé, à bien des égards, à la dislocation de cette unité, au point de penser que le plurilinguisme aurait pu mieux gérer le conflit rwandais.
D’autres groupes et individus ont chanté certaines valeurs notamment « les salutations en kinyarwanda », une des particularités identitaires des rwandais. Mboneye Eulade dans sa composition « Indamutso : salutations », chante presque intégralement les diverses formules de salutations existant dans la culture rwandaise. Il interpelle les jeunes pour mieux garder ce patrimoine intergénérationnel. On doit veiller à ce qu’il ne soit envahi ou supplanté par des cultures intrusives. Quelques unes des ses salutations en rwandais :
– Muraho/muraho namwe/yego : – Vous êtes vivants ? Réplique : Renvoie à la même formule « -Vous êtes vivants vous aussi » ou simplement répondre « oui »
– Gira son na nyoko – Aies ton père et ta mère
– Gira abana, gira umugabo/umugore – Aies les enfants, Aies un mari/ aies une femme (des vœux pour fonder une famille)
– (Gira Imana y’i Rwanda) – Aies le dieu du Rwanda
– Amashyo / – Amashongore – Aies beaucoup de troupeaux de vaches, Réplique : – Surtout les femelles
– Mwabonye Imana icyingura – Avez-vous vu Dieu ouvrir (la porte ?) ?
– Murare aharyana – Dormez dans un lieu qui vous démange (ceci signifie que pendant le sommeil, il faut être capable de réagir contre les bestioles qui vous piquent dans le lit. Etre capable de se mouvoir pendant le sommeil. Par cette salutation, on vous souhaite de se maintenir en vie au cours de ce passage inconscient proche de la mort)
La musique rwandaise joue également un très grand rôle dans la vie du citoyen ordinaire. Elle critique certains travers et abus qui relèvent du quotidien, notamment le manque d’hygiène, les dépenses démesurées, la paresse, l’exode rural, le célibat sans fin, etc.
 Après 1994, un autre type de musique est née notamment à travers la chanson. La forme et les thèmes ne sont plus les mêmes. De nouveaux musiciens s’installent. Le thème de la douleur et de la tristesse est très présent chez certains (Nyiranyamibwa), celui de la victoire du FPR prédomine chez d’autres (Muyango). En tout cas, ces deux thèmes ont archidominé le premier quinquennat. Cette période a été suivie d’une certaine mutation thématique. A partir des années 2000, un certain nombre d’artistes évoquent, avec un certain recul, des thèmes de la réconciliation, de la vie des rescapées, de la vie dans les prisons, etc. Alexandre Kagambage chante, à titre d’exemple, « Ikiremwamuntu nicyubahwe :(Que les droits humains soient respectés). Cette chanson reprend sans détours les principes fondamentaux des droits humains. Certains passages retiennent plus particulièrement l’attention :
Après 1994, un autre type de musique est née notamment à travers la chanson. La forme et les thèmes ne sont plus les mêmes. De nouveaux musiciens s’installent. Le thème de la douleur et de la tristesse est très présent chez certains (Nyiranyamibwa), celui de la victoire du FPR prédomine chez d’autres (Muyango). En tout cas, ces deux thèmes ont archidominé le premier quinquennat. Cette période a été suivie d’une certaine mutation thématique. A partir des années 2000, un certain nombre d’artistes évoquent, avec un certain recul, des thèmes de la réconciliation, de la vie des rescapées, de la vie dans les prisons, etc. Alexandre Kagambage chante, à titre d’exemple, « Ikiremwamuntu nicyubahwe :(Que les droits humains soient respectés). Cette chanson reprend sans détours les principes fondamentaux des droits humains. Certains passages retiennent plus particulièrement l’attention :
- « Nta guhanwa udahamwa icyaha, nta guhezwa mu buroko nta cyo ushinjwa (La justice ne doit pas condamner sans preuve, on doit éviter de garder en prison un innocent)
- Utotezwa ahabwe uburenganzira bwo guhungira aho ashaka… (une personne victime de menaces devrait bénéficier du droit d’asile dans un pays de son choix…)
- Ntawe ugomba guhezwa cyangwa abuzwe kuyoboka amadini n’amashyaka iyo bidahungabanya umutekano (Personne ne doit être victime du choix de sa religion ou de son parti politique lorsque ces derniers ne troublent pas l’ordre public) …
Les artistes Masabo Nyangezi, Jean Baptiste Byumvuhore, Kizito Mihigo, et d’ autres encore lancent un appel sans précédent pour une réconciliation à part entière. Outre les rwandais qui ont été tués dans le génocide des tutsi, ces artistes (hutu et tutsi) semblent dire, dans certaines de leurs chansons, qu’il existe d’autres rwandais tués dans la même période (par vengeance, morts en prison, par les maladies inhérentes à la guerre, etc.) et qu’il ne faudrait pas les oublier. Certains de leurs titres sont plus expressifs que d’autres, en l’occurrence Bose tubibuke (Mémoire pour tous de Masabo), Nanjye ga ndibuka (Et moi aussi je peux avoir ce droit de mémoire de Jean Baptiste Byumvuhore) et tout récemment Igisobanuro cy’urupfu (explication de la mort de Kizito Mihigo).
De la commende à la pression politique :
Un art aussi populaire ne peut échapper, au Rwanda en tout cas, aux commendes et à l’instrumentalisation des pouvoirs politiques. Quand ces derniers ne parviennent pas à ce genre de manœuvres, ils passent à l’échelon supérieur, celui des menaces. Avant 1994, certains artistes ont été censurés, mis en prison, séquestrés et parfois tuées sous prétexte interprétatif que telle ou telle chanson prétend soutenir l’ennemie (le FPR à l’époque). D’autres musiciens ont été la cible de la commende ou de la menace et ont cédé vaille que vaille à l’instrumentalisation. Ils ont tour à tour chanté les personnages politiques en déroute. Ils ont de temps en autre venté les mérites des pouvoirs défaillants ou simplement ont soutenu, par le chant, les politiques qui conduisaient clairement à l’échec.
La question majeure est de savoir, dans un contexte actuel, si ce passé récent aura donné un certain nombre de leçons aux artistes et aux pouvoirs actuels et futurs. L’avenir le dira certainement. En tout état de cause, la musique et les musiciens rwandais sont la richesse nationale à préserver, eu égard à leur rôle dans une société déchirée par les conflits cycliques.
Bref, on ne saurait prétendre, par ces quelques lignes, avoir tout dit sur la musique rwandaise (ancienne et moderne). Il s’agit simplement d’un avant-goût qui permettra, au fil du temps, d’exploiter cette sublime richesse culturelle.
Une chose est sûre, autant les rwandais écoutent leur musique, autant celle-ci semble à son tour les écouter et prendre parfois de l’avance sur eux. C’est une musique capable d’anticiper et d’éclairer mais aussi une musique susceptible de tomber dans les errements, surtout quand elle est manipulée par les mains et les esprits dépourvus de toute dextérité artistique.
Par Faustin Kabanza pour Info Afrique
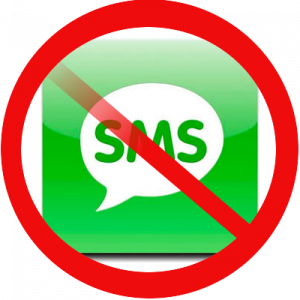 Les autorités centrafricaines ont décidé lundi de suspendre l’utilisation des SMS en vue de « contribuer à la restauration de la sécurité sur toute l’étendue du territoire ».
Les autorités centrafricaines ont décidé lundi de suspendre l’utilisation des SMS en vue de « contribuer à la restauration de la sécurité sur toute l’étendue du territoire ».